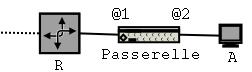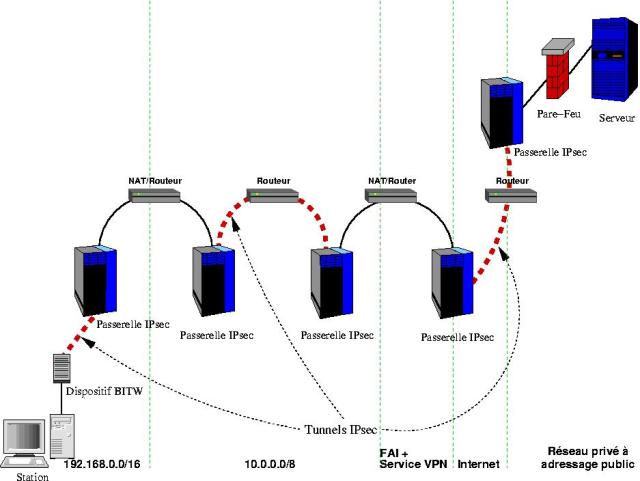|
Analyse de l'impact
-= Octobre 2002 =-
- Version 1.0 -
Sommaire
Introduction
L'IETF a commencé à acquérir une certaine inertie. L'âge des pionniers
d'Internet est terminé : de nombreux protocoles ont maintenant envahi les
noeuds et les feuilles du réseau. Certains de ces protocoles
fonctionnent dans des dispositifs spécialisés (routeurs, pare-feux,
etc.) qu'il est hors de question de remplacer, et d'autres sont intégrés
au niveau des stations, mais demeurent indéracinables car leur
fonctionnement est indispensable au réseau (ARP notamment). L'objet de
ce document est la présentation des incompatibilités entre ces
mécanismes et IPsec, incompatibilités qui sont sources de nombreux
retards de déploiement pour la sécurité de l'Internet.
Au fil de ce document, nous serons amenés à examiner
successivement les interactions entre IPsec et les
caractéristiques propres d'IP, entre IPsec et les protocoles de
transport, entre IPsec et les systèmes de résolutions
d'adresses, entre IPsec et les translateurs d'adresses et de
ports.
IPsec et IP
De nombreux protocoles envoient des données
répétitives d'un paquet à l'autre, notamment les
systèmes de diffusion d'informations (radio, webcam,
mais aussi
Router Advertisement, etc.). La distance de
Hamming (nombre de bits différents) entre les paquets
est alors réduite. Dans certains cas, cette distance
est nulle (i.e. les données avant chiffrement des
paquets sont identiques). Cela peut être fréquent avec
des protocoles se basant sur UDP ou directement sur IP.
La similitude entre paquets constitue une menace
importante pour la propriété de confidentialité
assurée par ESP. En effet, avec des chiffrements
classiques dans Z/pZ, ces similitudes sont exploitables
pour casser la clef de session plus rapidement ; et si
le temps de calcul demeure rédhibitoire, c'est-à-dire
que la communication ne pourra vraisemblablement pas être
déchiffrée pendant la durée de vie de la session, la
pérennité de la confidentialité des informations est
cependant compromise. Ainsi, si on considère deux
paquets pour lesquels les données sont identiques ou
peu différentes, sachant que les valeurs des vecteurs
d'initialisation sont explicites et que les règles de
construction du padding sont connues, les seules
données inconnues pour l'attaquant sont les textes en
clair et la clef de session. La distance entre messages
étant faible, une analyse différentielle est facilitée
(cf. §2.2 p.16 de
[ADP99]). En mode CBC, une
distance de Hamming faible entre vecteurs
d'initialisation facilite aussi une telle analyse (cf.
§1.2 de [KMS95], et §3 de
[MD98]).
Ce problème de similitudes entre données est mentionné
ici car, à défaut de constituer un problème
d'interaction au sens de l'ingénierie des protocoles,
il s'agit bien d'une interférence entre deux processus
- les données de couche supérieure et les traitements
d'IPsec - au sens de la théorie de l'information. Les
solutions sont donc à rechercher dans cette théorie.
Il s'agit principalement d'augmenter la distance de
Hamming entre paquets. Pour ce faire, plusieurs
solutions (classiques) se présentent :
IPsec soutient plusieurs positions face à la
fragmentation :
Ce comportement induit plusieurs problématiques;
considérons le schéma suivant :
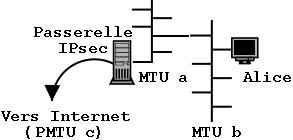
Dans ce schéma, on imagine que Alice communique avec
une machine quelconque située sur Internet. La machine
située avant l'accès à Internet est la passerelle de
sécurité IPsec. Comme les paquets émis par Alice
traversent deux réseaux de MTU différentes avant
d'arriver à la passerelle, de la fragmentation peut
advenir. Le routeur à l'interface des deux réseaux peut
en effet prendre la décision de fragmenter ou renvoyer
un message
ICMP_PMTU. Si un réseau radio et/ou un
réseau ad-hoc interviennent dans les réseaux a ou b, la
probabilité de fragmentation est élevée (l'envoi du
message ICMP_PMTU est soumis à d'autres
problématiques : voir plus bas).
En mode tunnel, cela ne pose aucun problème : IPsec
encapsule les paquets IP indépendamment du fait qu'ils
soient des fragments ou non.
En mode transport, le réassemblage des paquets est
nécessaire (cf. §3.1 de
[KA98-3] et de
[KA98-1]) avant d'appliquer la protection.
Cela pose un problème de performance et la
rentabilité est tout de suite remise en cause : le
paquet sera sans doute découpé à nouveau en fragments
pour pouvoir être envoyé sur Internet (En général, le
PMTU sur un chemin en dehors du réseau est inférieur à
celui du réseau).
Les considérations précédentes ont mis en exergue des
limitations qui sont tout à fait acceptables pour les
passerelles de sécurité : mode tunnel obligatoire. Par
ailleurs, si une fragmentation est requise
postérieurement au traitement opéré par IPsec, celle-ci
se produit dans le contexte des mécanismes classiques
d'IP et demeure totalement transparente pour IPsec (un
réassemblage a lieu à l'arrivée avant vérification par
IPsec).
En revanche, ces limitations constituent un
inconvénient majeur pour les dispositifs BITW (Bump In
The Wire) ou BITS (Bump In The Stack). Si ces
équipements travaillent en mode transport, des pertes
de performances sont à craindre, du fait du
réassemblage et de la refragmentation des paquets.
S'ils travaillent en mode tunnel, une adresse IP doit
leur être allouée - ce qui réduit la « transparence » du
dispositif -, et ils doivent informer leurs
clients que le PMTU est pour eux inférieur à celui du
lien (puisque le tunnel rajoutera de l'overhead), ou
alors ils doivent fragmenter en sortie du tunnel.
A la réception, que ce soit en mode transport ou en
mode tunnel, un réassemblage est nécessaire
en cas de fragmentation entre les systèmes mettant en
jeu IPsec.
Or, IPv4 n'impose absolument
pas de désactiver le drapeau
MORE_FRAG et de
rendre nulle la valeur du champ OFFSET à l'issue
du traitement de réassemblage (voir §3.4.1
de [KA98-2] et [KA98-3]). Cela
implique la modification de toute pile IPv4 sur
laquelle on désire implémenter IPsec, de façon à ce que
ces champs aient des valeurs avant le traitement de la
sécurité.
Par ailleurs, de par le fait que de nombreux routeurs
sur Internet prennent d'eux-mêmes la décision de
modifier le bit
DF (Don't Fragment), AH ne
protège pas ce champ, ni le
Fragmentation_Extension_Header dans le cadre d'IPv6.
La perte de fragments signifie souvent la perte des
données protégées. Dans les cas où seules
l'authentification et l'intégrité sont assurées (AH et
ESP sans chiffrement), une analyse des fragments
récupérés pourrait fournir des renseignements exploitables
par le destinataire (dans les cas graves où
l'information est vitale). En revanche, quand du
chiffrement est mis en place, certains fragments sont
critiques afin de retrouver le contexte de sécurité
(clefs, algorithmes) à appliquer pour analyser
les fragments qui ont pu arriver jusqu'à destination.
Un attaquant peut exploiter les mécanismes de
fragmentation/réassemblage pour provoquer des dénis de
service et empêcher ainsi la mise en place de nouvelles
associations de sécurité. Dans toute implémentation
d'IP, des ressources
(mémoire surtout) sont réquisitionnées afin de
conserver les fragments dans des buffers. IPsec ne fait
pas exception, et si un attaquant inonde une passerelle
de sécurité avec des fragments, ce type de déni de
service peut advenir.
En effet, déterminer si un fragment provient d'un
homologue
de confiance n'est pas évident : les informations
peuvent être incomplètes, ou l'association de sécurité
peut être en cours de création. Notamment, IKE, SIGMA,
JFK et IKEv2, utilisent UDP et envoient des messages de
taille relativement importante (supérieure à 500 octets,
taille minimale à partir de laquelle une fragmentation
est légale), et sont donc particulièrement
sensibles à cette attaque : les fragmentations
« légitimes » peuvent arriver, et les implémentations
sont donc obligées de conserver l'état de l'échange;
voir §2.4 p 5 de
[H3KP02-1], §3.1 de [Hof02].
Une solution est décrite §2.6 de
[H3KP02-2] :
si la probabilité d'être sous le feu d'une attaque est
élevée, un mécanisme doit pouvoir informer le système
de réassemblage de n'accepter que les fragments UDP
issus d'adresses pour lesquelles un cookie valide a été
reconnu. Cela implique que les messages
d'initialisation (IKE_SA_init) soient d'une
taille inférieure à 500 octets (i.e. ils ne peuvent
être fragmentés) afin de pouvoir servir un cookie aux
nouveaux arrivants.
Les modules IPsec BITS (``Bump In The Stack'') occupent
une position délicate. Ces implémentations d'IPsec
viennent s'intercaler entre les pilotes de carte réseau
et la couche IP, dans des systèmes pour lesquels les
sources de la couche IP ne sont pas disponibles ou
librement modifiables. En mode transport, l'utilisation
de tels dispositifs ne pose aucun problème de routage,
de même en mode tunnel si l'extrémité du tunnel
correspond à la destination des paquets. En revanche,
toujours en mode tunnel, si la destination finale n'est
pas l'extrémité du tunnel ou si l'hôte effectue du
multi-homing, l'emplacement de ces
modules dans la pile peut rendre difficile les décisions
d'acheminement : comment ces dispositifs pourraient-ils
prendre une décision de routage et déterminer la bonne
interface et la bonne passerelle pour acheminer le
paquet en sortie du tunnel ? Ce rôle revient plutôt à la
couche IP, mais cette dernière n'est pas sensée savoir
qu'un traitement de type tunnel a eu lieu, puisqu'il
s'agit d'un module BITS. Etablir un diagnostic peut
alors être difficile, car si la destination finale est
la machine locale ou si le couple (interface, next hop)
requis pour l'acheminement correspond à celui par
défaut, tout fonctionnera correctement ! En §15.2.B.2.b
de
[KA98-1], deux « moindres maux » pour
faire face à ce problème sont présentés :
Un autre problème d'acheminement des paquets se
pose en mode tunnel...

Sur le schéma précédent, quand Alice désire envoyer un
paquet à Bob, la passerelle de sécurité d'Alice analyse
la destination du message. La politique de sécurité
impose la création d'un SA pour toute communication
avec le domaine d'où est issu Bob... Mais comment la
passerelle détermine-t'elle les adresses IP des
passerelles du domaine de Bob, et comment choisit-elle
avec quelle passerelle établir un SA ? Il n'existe pas,
actuellement, de mécanisme permettant la découverte de
passerelles IPsec ou de résoudre la situation de
multihoming. Il est nécessaire que la passerelle
d'Alice connaisse celle de Bob. Le draft
[BKRS02] (août 2002) énonce en §3.2.2 qu'un
protocole permettant la
découverte des passerelles de sécurité est une
nécessité pour le groupe IPSP (``IP Security Policy'').
Diverses propositions apparaissent épisodiquement (elles
ont maintenant expiré), mais aucune ne semble s'imposer.
L'utilisation du ``Remote Discovery Protocol'' (RDP) de
Cisco - à ne pas confondre avec ``Cisco Discovery
Protocol'' (CDP), qui fonctionne uniquement au niveau 2
- avait été présentée lors du 52ème congrès IETF,
sans grand succès.
D'un point de vue général, les mécanismes de
confidentialité cohabitent mal avec ceux de monitoring
ou de filtrage. Les systèmes de détection d'intrusion
(IDS) voient ainsi leur utilité réduite. L'information
pertinente qu'ils peuvent renvoyer sont les éléments de
protocoles (adresses, options...) et les
caractéristiques des échanges (volume total de
communication, direction de la communication). Ces
caractéristiques mesurables peuvent cependant être
faussées, par exemple via l'utilisation du ``Traffic
Flow Confidentiality'' (TFC), qui consiste
à faire du bourrage dans les paquets avec des octets
inutiles avant chiffrement. L'utilisation conjointe
d'IPsec et de systèmes de monitoring nécessite une
évaluation des besoins (confidentialité nécessaire ?)
et une analyse du réseau (où placer les machines IPsec
et où placer les sondes ?).
Les mécanismes actifs effectuant un filtrage selon des
caractéristiques des paquets sont aussi tenus en échec.
Les pare-feux sont bien sûr les premiers acteurs
concernés; ils nécessitent l'autorisation des
protocoles AH et ESP, et l'ouverture du port 500 pour
IKE, tout cela sans pouvoir déterminer le contenu utile
du trafic ! Cela nécessite une certaine confiance; il
est donc plus judicieux de combiner le firewall et la
passerelle de sécurité, ou de le placer après la sortie
du tunnel (une fois la tâche d'IPsec accomplie). Il
existe cependant d'autres mécanismes actifs dont on
peut ignorer l'existence jusqu'au moment où l'incident
survient : ponts (bridges) et autres systèmes assurant
la transition entre plusieurs réseaux gérés par des
opérateurs différents. Notamment, dans le cadre d'un
accès à Internet, les messages ICMP
Fragmentation
Needed sont souvent bloqués par les FAI, et il est
alors nécessaire de fixer le Maximum Segment
Size (MSS) de TCP par rapport à la MTU. De la même
manière, une adaptation de la taille des paquets est
nécessaire quand un routeur fait la transition entre
une interface IP/802.3 et une interface IP/PPPOE/802.3.
Ces traitements peuvent affecter les preuves
d'intégrité d'IPsec (cf. [Bou02]).
On pourrait objecter à l'utilisation d'un firewall les
capacités de filtrage d'IPsec, plus précisemment les
SAD ``Traffic Selectors''. Malheureusement, ce système
fait preuve d'un comportement peu cohérent (voir plus
bas).
ICMP est un protocole essentiel pour le fonctionnement
des protocoles ou des applications qui s'appuient sur
IP. En acheminant une description sommaire des erreurs
rencontrées sur le réseau, il permet d'obtenir des
informations importantes sur cette boîte noire (et peu
bavarde) qu'est le réseau IP. Malheureusement, le
[Pos81-1], qui décrit ICMP, est relativement
ancien et n'a absolument pas été conçu dans un contexte
de sécurité. Certaines fonctionnalités de ICMP semblent
compatibles avec IPsec, plus précisément toutes celles
qui impliquent un échange entre deux hôtes :
(ECHO,ECHO_REPLY) et
(TIMESTAMP,TIMESTAMP_REPLY). Les messages
INFORMATION_REQUEST et INFORMATION_REPLY
peuvent être protégés dans le cas d'une communication
d'hôte à hôte, mais aucune méthode standard n'existe
(la nature de cet échange proscrit l'usage d'un AS
classique). Une variante de INFORMATION_REQUEST
est l'interrogation du réseau, qui ne peut être
sécurisée par des moyens standardisés (la réponse reste
un message d'hôte à hôte, et peut être protégée).
Tous les messages pouvant être générés en un point
quelconque du réseau ont une compatibilité faible avec
IPsec : DESTINATION_UNREACHABLE,
SOURCE_QUENCH, REDIRECT,
TIME_EXCEEDED, PARAMETER_PROBLEM;
compatibilité faible, car seul un système ayant la
possibilité de partager un SA avec le destinataire
peut envoyer de façon sécurisée ces messages. Cela
implique, d'un point de vue général, qu'il est
impossible de faire confiance aux routeurs
intermédiaires sur lesquels transitent les paquets
protégés (cela nécessiterait une PKI à laquelle
souscriraient les routeurs intermédiaires : absurde et
dangereux à grande échelle pour le pouvoir que cela
donnerait au maître d'une telle PKI). L'usage du
routage de source pourrait peut être permettre de
déterminer si un routeur a légitimité pour
envoyer un paquet ICMP, mais cela ne prouvera pas
pour autant son honnêteté. En effet, les 64 bits
d'informations obligatoires (en plus de l'en-tête IP)
que ICMP doit retourner sont insuffisants pour prouver
cette légitimité : cela correspond aux informations
suivantes dans les protocoles AH et ESP :
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Next Header | Payload Len | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | RESERVED | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Security Parameters Index | | (SPI) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Security Parameters Index | | (SPI) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Sequence Number | | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Parmi ces informations, le SPI apporte un renseignement
intéressant. Cependant, il est insuffisant pour
déterminer l'hôte à qui acheminer le message si IPsec
est utilisé sur une passerelle de sécurité, ou pour
acheminer au bon protocole de niveau transport (par
exemple, pour un message
DESTINATION_UNREACHABLE de type
PORT_UNREACHABLE). Si ESP est utilisé, une table
de correspondance peut associer les adresses sources
des paquets qui ont été récemment émis dans le tunnel
et le numéro de séquence avec lequel ils ont été
envoyés (le numéro de séquence n'est pas chiffré par
ESP). Cela permet de retrouver l'émetteur interne du
paquet problématique. Cependant, encore une fois, tout
cela ne prouve pas la « bonne foi » du routeur
émetteur du message.
[KA98-1], §6 suggère, en l'absence de preuve
d'authentification, d'ignorer les messages ICMP autres
que REDIRECT et ICMP_PMTU, qui sont
critiques au fonctionnement. Dans tous les cas, les
politiques de sécurité locales doivent permettre
l'interdiction/l'autorisation par type de message ICMP.
En l'absence de mécanismes de substitutions à ces
messages de ICMP, cette stratégie semble la meilleure,
bien qu'elle ouvre la porte à des dénis de service
relativement simples à mettre en oeuvre (redirection
illicite ou réduction extrême de la bande passante).
Curieusement, le traitement spécifique de
ICMP_PTMU fait l'objet d'un développement
important dans le §6.1.2 de [KA98-1], alors
que plus de
précisions auraient aussi été bienvenues sur le message
REDIRECT.
Des stratégies identiques peuvent
cependant être définies pour ces deux messages. Si la passerelle
peut déterminer la source du paquet problématique, ou
réduire les sources potentielles (``possible
originating hosts'') à un nombre *raisonnable*
(``manageable number''), elle doit relayer les
messages ICMP directement. Sinon, elle mémorise
l'information et la relaye à la prochaine source qui
utilise l'AS en question dans les conditions fautives
(MTU du paquet trop importante, etc.). Cela implique de
recalculer le PMTU renvoyé à la source en fonction de
l'overhead occupé par l'encapsulation par IPsec en mode
tunnel. Par conséquent, les messages ICMP arrivant du
tunnel déclenchent la construction de nouveaux messages
ICMP. Ces mesures « frôlent » les limites
imposées dans
le §1 de [Pos81-1] : Un message ICMP ne doit
pas être envoyé à propos d'un message ICMP; de
plus la granularité des messages peut varier suivant la
nature des implémentations (BITS, BITW, native, etc.),
et un mécanisme doit définir une durée de vie sur les
informations mémorisées (afin que le PMTU ne reste pas
figé dans le temps).
Indépendamment d'IPsec, une mise à jour globale de ICMP
s'impose, notamment en ce qui concerne les 64 bits de
données transportés, issus du paquet original : dans le
RFC, cette quantité de données est exacte, alors que
dans la réalité, elle est considérée comme un minimum.
Il est donc très classique de trouver des messages ICMP
avec 96 bits de données ou plus. Ces informations
supplémentaires (si elles ne sont pas chiffrées)
peuvent soulager IPsec pour les
traitements de ICMP (§15.3.1.B.3.1 de
[KA98-1]. Malheureusement, il n'est
pas vraisemblable de faire évoluer toutes les
implémentations actuelles de ICMP, étant donné le
nombre de machines impliquées. L'apparition de
passerelles avec des comportements spécifiques est
donc à envisager.
[FS00] présente le problème comme
insoluble, compte tenu du travail de mise à jour à
effectuer, et de l'échelle des interactions.
Comme cela a été évoqué précédemment, de nombreux
traitements sont susceptibles de modifier les paquets
sur le réseau, ce qui limite l'intérêt des preuves
d'intégrité, notamment celle apportée par AH, bien que
le
[KA98-2] classe très clairement les
champs de IP en mutable, immutable,
predictable. Avec le développement de nouveaux
types de traitements ou de nouvelles options pour IPv4,
des incidents sont envisageables. Cela s'est notamment
produit avec l'ajout de la notification explicite
d'engorgement (ECN - [3168]) : le §9.2
(``IPsec Tunnels'') de ce RFC décrit une quantité non
négligeable de modifications à apporter à IPsec,
notamment au traitement des entêtes, aux bases
d'associations de sécurité, aux bases de politiques de
sécurité, aux protocoles de négociations, au mode
tunnel, etc. Le sujet étant particulièrement pointu et
l'adoption de ECN semblant des plus aléatoires (voir le
paragraphe sur ECN dans Documentation/Configure.help
des sources du noyau linux), il n'en sera pas plus
question ici.
IPsec et la Couche Transport
De nombreuses confusions réapparaissent à intervalles
réguliers sur les listes liées à IPsec (ipsec,
freeswan, ipsp, etc.) entre les différents filtrages
opérés par IPsec. Il convient de distinguer :
SCTP
[SCTP00] est un protocole de
transport fiable conçu pour
fonctionner sur des réseaux de type paquets, et
notamment sur IP. Il est prévu de l'utiliser
principalement, mais pas exhaustivement, dans les
réseaux de téléphonie publique commutés (PSTN).
La caractéristique de SCTP qui pose problème peut se
présenter aussi dans les futurs protocoles de
transport : les sessions SCTP associent un groupe
d'émetteurs à un groupe de destinataires.
Cela a deux conséquences sur les traitements opérés par
IPsec (cf.
[BIKS02]) :
Avec le développement des réseaux IP, de nombreux
protocoles sont destinées à naître, avec des
caractéristiques au moins aussi complexes que celles
de SCTP.
Malheureusement, il est difficile d'anticiper sur ces
développements. L'évolution de la technologie IP a
déjà longtemps été considérée comme surprenante.
SIP est un protocole de signalisation pour les
conférences, la téléphonie, la messagerie instantanée,
la signalisation de présence ou d'événements (
[Ros02]). Les interactions entre SIP et IPsec
ne sont pas spécifiques à SIP, i.e. des interactions
similaires se produisent avec d'autres protocoles,
comme DNS, NFS... Cependant, SIP est particulièrement
touché, pour des raisons de performances. Le groupe SIP
étant très actif et surtout très productif, il est
probable que tout un ensemble de documents viendront
préciser les comportements de sécurité liant SIP à
IPsec (cf. thread du 26 Septembre 2002 sur la liste
IPsec : ``Protocol and port fields in selectors'',
[Kry02]).
Le point à problème concerne les sélecteurs de trafic
dont il a été question plus haut. SIP emploie le même
numéro de port pour son trafic, que celui-ci soit un
port UDP, TCP ou SCTP; et l'usage de ces trois
protocoles se fera de façon non-déterministe (au
contraire de l'utilisation de UDP ou TCP pour le DNS)
et intensive. Créer un sélecteur de trafic pour chaque
protocole de transport pose alors des problèmes
importants de performances (Les proxy SIP doivent
pouvoir supporter des charges très importantes de
trafic). De plus, l'arrivée de nouveaux protocoles de
transport tels que DCP (Datagram Control Protocol),
etc., rendent nécessaire la recherche d'une réponse
systématique à la question des SA
mono-port/multi-protocoles.
Comme il a été précisé plus haut (cf. « Les Sélecteurs
de Trafic »), seules certaines implémentations
permettent de construire des sélections de ce type.
TCP est une source réelle de challenges
d'interopérabilité pour de nombreux systèmes
fonctionnant avec IP. Le reproche principal qui est
fait à TCP est la méthode de calcul de son checksum :
Extrait de
[Pos81-2] :
The checksum also covers a 96 bit pseudo header conceptually
prefixed to the TCP header. This pseudo header contains the Source
Address, the Destination Address, the Protocol, and TCP length.
This gives the TCP protection against misrouted segments. This
information is carried in the Internet Protocol and is transferred
across the TCP/Network interface in the arguments or results of
calls by the TCP on the IP.
En d'autres termes, le checksum de TCP incorpore des
données caractéristiques de la couche IP de l'émetteur
et du récepteur. Voici le détail des pseudo-entêtes en
IPv4 et en IPv6 (
[DH98]).
+--------+--------+--------+--------+ | Source Address | +--------+--------+--------+--------+ | Destination Address | +--------+--------+--------+--------+ | zero | PTCL | TCP Length | +--------+--------+--------+--------+ Pseudo-entête TCP/IPv4
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | + + | | + Source Address + | | + + | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | + + | | + Destination Address + | | + + | | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Upper-Layer Packet Length | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Zero |Next Header| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Pseudo-entête TCP/IPv6
Plusieurs processus de niveau IP ont besoin de modifier
les adresses IP pendant le transit, et notamment les
systèmes de translation d'adresse. Dès lors, il suffit
de modifier le checksum lorsqu'un tel traitement est
effectué. Lorsque IPsec est utilisé de bout en bout,
cela aboutit inévitablement à une erreur : si le paquet
est protégé par chiffrement, il est impossible de
recalculer le checksum pour le remettre à jour; si le
paquet est protégé par authentification/intégrité,
l'altération du checksum provoquera une erreur de
vérification par IPsec. Ce sujet est particulièrement
complexe, puisque de nombreux processus interviennent :
NAT, AH ou ESP, TCP, mais aussi IKE (comment négocier
un AS à travers un NAT ?), etc.
TCP est un protocole connecté. L'établissement des
connexions et leur libération se fait sous la forme de
paquets IP dont le contenu peut être déterminé très
facilement (
SYN,SYN/ACK,RST...).
Cette situation permet une attaque par séquences connues
pour casser les clés de session utilisées par IPsec (cf.
§2.2 p15 de [ADP99]).
Les traitements opérés au sein du réseau peuvent
provoquer des pertes de paquets ou des ralentissements.
Dans certains cas, les timers qui assurent les
déblocages des états de l'automate de TCP peuvent
arriver à expiration (ce qui déclenche généralement un
call-back de traitement d'erreur pour l'application ou
provoque un
SIG_SEGFAULT suivi d'un
coredump). IPsec s'en tire en général
relativement bien à ce niveau : les précautions prisent
dans la conception des systèmes afin de lutter contre
le déni de service font que les temps de traitement
sont limités (limitation de la fragmentation, file
d'attente d'exposants pré-calculés, etc.). Cependant, en
cas de forte charge, des latences importantes restent
probables. Prenons pour exemple le cas d'un passerelle
de sécurité qui redémarre. Les connexions TCP avec les
``peers'' (autres passerelles ou télétravailleurs) ont
été rompues brusquement et doivent donc être
re-établies. Il en résulte tout un ensemble de
SYN TCP, lesquels déclenchent des négociations
d'associations de sécurité, lesquelles sont
consommatrices en échanges, calculs et mémoires. La
passerelle étant chargée, les associations de sécurité
peuvent ne pas être établies avant la fin de l'attente
par TCP du SYN/ACK. Il s'agit plus d'une gêne
occasionnée à l'utilisateur que d'un inconvénient
majeur dans la plupart des cas. Cependant,
l'utilisateur doit comprendre ce qui se passe et savoir
qu'il peut relancer la connexion sans souci une fois
l'AS établie. Une solution simple pour éviter ces
désagréments est d'augmenter les temps d'attente.
Enfin, TCP requiert pour un fonctionnement optimal un
acheminement correct des messages ICMP. Par exemple,
une application peut gérer de deux façons différentes
la reprise sur erreur dans le cas de la réception d'un
message
DESTINATION_UNREACHABLE d'une part, ou
dans le cas de l'expiration d'un timer d'autre part. La
distinction entre PORT_UNREACHABLE et
HOST_UNREACHABLE constitue aussi une information
riche pour l'application. Par ailleurs, une
implémentation de TCP peut gérer les informations
issues de la notification explicite de congestion (ECN;
voir plus haut). Lorsque, en cas d'erreur, TCP attend
un message ICMP qu'il ne recevra pas (parce qu'il est
filtré par IPsec ou par un firewall), il peut rester
bloqué en attente jusqu'à l'expiration du timer. Une
solution simple pour éviter ces désagréments est de
réduire les temps d'attente.
On notera que les deux solutions simples
sus-mentionnées sont antagonistes (augmentation
vs réduction des timers TCP).
L'analyse précédente effectuée sur TCP nous amène à
faire une brève digression sur UDP. En effet,
l'entête UDP contient aussi un checksum, construit de
la même façon que pour TCP : cf. §2,§3 de
[Pos80].
En réalité, si ce checksum contient une information
intéressante, sa prise en compte demeure de la
responsabilité de l'application s'appuyant sur UDP.
Le RFC précise à ce niveau qu'un checksum de
0x00 est associé à une signification
particulière : ``debug'' ou « l'application supérieure ne
s'intéresse pas au checksum ».
Afin d'en savoir plus, j'ai procédé à une observation
de divers paquets UDP sur le réseau. Le checksum
inclus dans les paquets est systématiquement non nul.
Cependant, les valeurs des checksums ne se sont pas
toujours révélées correctes dans certaines requêtes
DNS (
Standard_Query_PTR). Cela n'a pas empêché
le serveur de noms de répondre correctement à ces
requêtes. On peut donc conclure directement que
certaines implémentations ne
prennent pas en compte la vérification du checksum.
Il est à craindre que de très rares protocoles ou de
rares implémentations de protocoles connus fassent
cette vérification, auquel cas une incompatibilité
NAT/IPsec/checksum_UDP est à craindre.
Je n'ai pas connaissance de l'existence de tels
protocoles ou implémentations.
IPsec et les protocoles de résolutions d'adresses
ARP permet d'associer des adresses IP et des interfaces
réseau. Considérons un exemple simple :
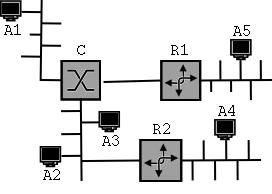
Le schéma ci-dessus représente un ensemble de réseaux
ethernet interconnectés. A1, A2 et A3 appartiennent
au même sous-réseau IP (pas de VLAN ethernet).
Dans le cas où A1 veut discuter avec A2, A1 doit
connaître l'adresse ethernet de A2, sinon le commutateur
C ne sera pas en mesure d'acheminer les trames ethernet
de A1 vers A2.
A2 et A3 sont sur un ethernet partagé. En conséquence de
quoi, A3 reçoit systématiquement tout le trafic issu de
A2, même celui qui ne lui est pas destiné. Il pourrait alors
différencier les paquets qui lui sont destinés par
l'adresse IP destination. Il n'est donc pas nécessaire,
en théorie, que A2 connaisse l'adresse MAC de A3 pour
lui envoyer des trames; en réalité, pour des raisons de
simplicité, et parce que A2 ne sait pas a priori si A3
est sur le même ethernet partagé ou si il est accessible
via un commutateur, A2 cherchera tout d'abord l'adresse
MAC de A3, et A3 n'acceptera (dans le cadre d'une
utilisation normale) que les trames destinées à sa
propre adresse MAC). Il est intéressant de noter un
effet de bord
de ce scénario : dans certains systèmes
d'exploitation, lorsqu'une carte
ethernet est passée en mode d'écoute
(promiscuous - réception de
toutes les trames), la couche IP traite à son habitude
les paquets pour lesquels l'adresse IP destination
correspond à la machine locale. On peut donc repérer les
espions utilisant de tels systèmes : si par exemple A2 a
des doutes sur l'honnêteté de A3, il peut envoyer un
message
ICMP_ECHO (ping) avec pour destination
ethernet l'adresse MAC de A1, et pour destination IP
celle de A3. Si A3 répond (ICMP_ECHO_REPLY), cela
prouve bien qu'il espionnait le trafic.
Si A2 désire envoyer un paquet IP à A4, la couche IP de
A2 l'informe qu'il doit envoyer les trames ethernet au
routeur R2. On est donc ramené au cas précédent : A2
contacte un système sur l'ethernet partagé, et pourrait
donc le faire sans connaître l'adresse MAC de ce
système. R2, en recevant un paquet qui n'est pas adressé
à une machine du sous-réseau IP auquel appartiennent A1,
A2 et A3, peut prendre la décision de l'acheminer.
Cependant, cette situation devient complexe si deux
routeurs sont sur le même ethernet partagé. Il est alors
préférable que les stations s'adressent explicitement à
un routeur, via son adresse MAC.
Lorsque A1 cherche à contacter A5, sa configuration IP
l'informe que la passerelle est R1. A1 et R1 sont
séparés par un commutateur, par conséquent, comme
lorsque A1 contacte A3, la connaissance de l'adresse MAC
destination est nécessaire.
ARP permet de retrouver l'adresse de couche liaison de
données d'une machine à partir de son adresse réseau. Dans
l'exemple précédent, il s'agit d'obtenir l'adresse MAC à
partir de l'adresse IP. Sur ethernet, un broadcast
ethernet est effectué, et la machine qui reconnaît son
adresse IP répond en envoyant son adresse MAC à
l'émetteur (le broadcast ethernet est relayé par les
commutateurs). Dans d'autres types de réseau (les
réseaux NBMA), un serveur ARP reçoit les requêtes et y
répond.
ARP ne s'appuie pas sur IP et n'a pas d'interaction
directe avec IPsec. Par ailleurs, ARP ne peut pas être
sécurisé avec IPsec non plus.
Dès lors, on peut en tirer les enseignements suivants :
ARP autorise deux types d'attaques :
Usurper une identité n'est possible que sur un même
réseau IP. Dès lors, pour se faire passer pour quelqu'un
d'autre, l'attaquant forge des réponses ARP associant
sa propre adresse MAC à l'adresse IP du destinataire
usurpé.
Si les hôtes trompés utilisent directement IPsec localement
(sans passer par une passerelle), les conséquences de
l'attaque peuvent être réduites. Pour cela, il est
nécessaire que les hôtes disposent - avant toute
négociation - de moyens cryptographiques
pour s'authentifier mutuellement, par exemple:
Si l'hôte trompé utilise IPsec via une passerelle de
sécurité, alors les attaques par ARP peuvent
fonctionner. L'attaquant peut par exemple se faire
passer pour la passerelle auprès de l'hôte et pour
l'hôte auprès de la passerelle. La communication hôte -
passerelle n'étant pas sécurisée, l'attaquant a les
pleins pouvoirs sur le trafic issu ou à destination de
l'hôte. Pour éviter cela, il faut garantir les
associations (adresse IP, adresse MAC), ou sécuriser les
communications entre les hôtes et la passerelle, via
IPsec en mode tunnel par exemple; l'intérêt de la
passerelle est alors de séparer les associations de
sécurité locales de celles avec les systèmes étrangers
et de forcer l'application des politiques de sécurité.
Les attaques par ARP se faisant sur le réseau local,
elles sont souvent sous-estimées par les
administrateurs, qui considèrent que le réseau local est
« de confiance ». D'après le CLUSIF (cf. p25
de
[Clu01]), les incidents locaux constituent
cependant une part non négligeable des sinistres
informatiques. Par ailleurs, une machine corrompue par un
attaquant extérieur peut lui permettre d'enchaîner sur
des attaques locales via ARP.
Dans un contexte IPv6, ARP n'existe plus. On peut alors
imaginer de nombreuses solutions. Par exemple, si les
adresses IPv6 sont construites à partir de l'adresse
MAC, la connaissance de l'adresse physique est un
corollaire de celle de l'adresse réseau. En revanche,
connaître l'adresse réseau de son correspondant devient
plus difficile; cela augmente le travail du DNS. Si les
adresses IPv6 sont construites de façon arbitraire, les
hôtes peuvent connaître l'adresse physique des routeurs
via les
Router_Advertisement, et peuvent
découvrir leurs adresses respectives par le mécanisme
de Neighbor_Discovery. Cependant, ces techniques
ont leurs propres inconvénients en matière de sécurité
(nécessité d'avoir des groupes multicasts sécurisés,
d'authentifier les avertissements des routeurs, etc.).
Ces sujets constituent des pôles de recherche en cours
de défrichage, et aucun standard n'émergera avant
au moins un an ou deux.
Pour saisir comment DNS peut compromettre IPsec, il faut
dans un premier temps décrire les vulnérabilités du DNS.
Ces descriptions sont issues d'un rapport de l'ISP BGP &
DNS Working Group (
[Isp02]), rédigé dans
le cadre du ``National Security Telecommunications
Advisory Committee'' (créé par R. Reagan en 1982). Pour
des descriptions plus précises au niveau des
réalisations pratiques, se reporter à [AA02].
Vulnérabilités du DNS :
La mise en oeuvre d'IPsec peut provoquer un excès de
confiance que les faiblesses du DNS permettent à un
attaquant d'exploiter.
Tout d'abord, le DNS est indispensable au fonctionnement
du réseau. On pourrait imaginer des systèmes de très
haute sécurité dans lesquels les utilisateurs seraient
forcés de mémoriser des adresses réseau, mais dans un
monde de cryptographie omniprésente, cela n'a pas lieu
d'être, les mécanismes d'authentification étant là pour
répondre aux problèmes d'usurpation de nom(s). Avec
les perspectives d'évolution d'IP, et notamment la
mobilité et les systèmes d'adressage d'IPv6, la correspondance
nom - adresse IP perd de sa rigidité. Par conséquent, le
nom DNS demeure la solution la plus viable pour assurer
la disponibilité des services. Bien que doté d'une
structure arborescente et d'une autorité de gestion (le
NIC), le DNS n'est absolument pas sûr, et le pouvoir n'y
est pas centralisé. Aux extrêmes, il est possible de
trouver certains DNS qui rejettent totalement le NIC et
donnent leur propre vision de l'arborescence mondiale,
avec les risques que cela implique dans les
communications entre machines utilisant deux arbres DNS
différents et s'échangeant des noms (par exemple des
mails ou des URLs). Des solutions de sécurité pour le
DNS existent (DNSsec,
[Eas99]), mais leurs
besoins en termes de performances sont très importants,
de par l'usage de la cryptographie pour authentifier
des requêtes (pour éviter le rejeu, confirmer aussi
l'absence d'une entrée dans le DNS,
etc.). En conclusion, DNS est indispensable et ne sera
pas sûr avant longtemps.
Cela a des implications directe sur l'utilisation
d'IPsec, puisque les utilisateurs auront besoin du DNS
pour faire l'association entre un service et une
machine. Dès lors, cela implique que IPsec doit disposer
de règles de filtrage appropriées pour le DNS. Il est
évidemment hors de question de bloquer le DNS, il reste
donc la possibilité de protéger DNS par IPsec ou de le
laisser passer « en clair ». Protéger DNS par IPsec n'a
d'efficacité que si les correspondants sont tous les
deux décrits de façon correcte dans le même DNS avec
lequel s'établit la résolution de nom protégée, ou si
leurs descriptions sont accessibles dans des DNS qui
appartiennent à un même réseau de confiance (PKI ou
PGP). Par souci de clarté, considérons le schéma
suivant :
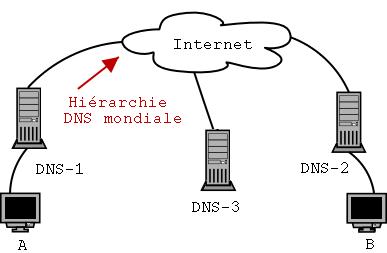
DNS-1 contient la description de A et DNS-2
contient celle de B, les liaisons A <-> DNS-1 et B
<-> DNS-2 sont protégées par IPsec. Si un
utilisateur de A cherche à contacter B par son nom, A
demandera à DNS-1 l'adresse de B. A partir de là,
plusieurs possibilités se présentent :
Considérons maintenant quelques scénarios d'attaque :
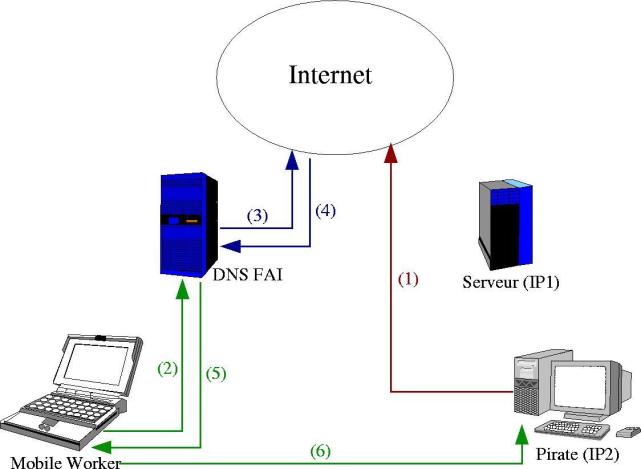
Dans ce scénario, un attaquant usurpe l'identité DNS
d'un serveur. Pour ce faire, il corrompt les données
d'un serveur DNS sur Internet (1), en profitant d'un
faux transfert de zone, en effectuant une fausse
réponse, une mise à jour dynamique, etc. Il associe le
nom du serveur à son adresse (IP2). Par la suite,
un télétravailleur désire se connecter
au serveur. Son application est un simple browser, et
il saisit l'URL du serveur, par son nom. En temps
normal, une fois l'adresse IP (IP1) du serveur
récupérée, la pile IPsec locale
observe qu'une entrée existe dans la base des politiques
de sécurité pour l'adresse IP destination (IP1) et
déclenche donc IKE pour établir une association de
sécurité avec le serveur.
Sauf qu'ici, la résolution DNS renvoie une
fausse réponse : le client demande l'adresse IP du
serveur au DNS du FAI (2), qui fait remonter la
requête (3) jusqu'à un DNS qui lui fournit la réponse
forgée par l'attaquant. L'information est alors
redescendue (4) jusqu'au client (5). L'adresse IP2 n'est
pas listée dans le SPD, donc IKE n'établit pas
d'association de sécurité, et la politique par défaut
s'applique (acheminement en clair ou rejet du paquet).
Il y a donc soit détournement de connexion, soit déni de
service. Pour éviter ces soucis, il est possible :

Dans ce scénario, un utilisateur cherche à contacter un
serveur depuis son réseau d'entreprise. Le serveur peut
appartenir à un réseau protégé par une passerelle de
sécurité ou disposer lui-même d'IPsec.
De la même manière que précédemment, l'utilisateur
rentre l'URL du serveur dans un browser. Normalement, la
passerelle de sécurité, en voyant partir la requête http
à destination du serveur doit la faire transiter dans un
tunnel IPsec. Cependant, le pirate a empoisonné un cache
DNS ou envoyé une mauvaise réponse à un
DNS_Query. Lorsque l'utilisateur déclenche la
résolution de nom (2), le DNS interne interroge le DNS
du provider en passant sans dommage par la passerelle de
sécurité (3). Le DNS du provider récupère depuis
Internet l'information corrompue par le pirate (4)(5),
et la fait parvenir au DNS interne (6), qui renvoie au
client (7). Le client envoie alors ses paquets http à
la mauvaise adresse, et comme la passerelle de sécurité
n'a pas de politique de sécurité particulière pour cette
adresse, le traitement par défaut est effectué : rejet ou
acheminement sans protection. Bien souvent, il s'agira
d'acheminement sans protection (8), et le pirate mettra en
place un faux serveur web lui permettant de duper
l'utilisateur. Ce dernier peut ne se rendre compte de
rien, sauf s'il remarque que la machine avec laquelle il
communique n'a pas la bonne adresse IP ou que la
connexion s'est établie trop vite (i.e. il n'y a pas eu
le ralentissement caractéristique dû aux constructions
des associations de sécurité, mais ce ralentissement
peut aussi être simulé par le pirate !).
Les solutions à mettre en oeuvre sont similaires
à celles présentées dans le scénario précédent.
Dans les scénarios 1 et 2, l'étape de protection par
IPsec est évincée par l'attaquant par une attaque sur le
DNS. Dans le scénario suivant, IPsec est effectivement
mis en oeuvre, mais détourné au profit du pirate.
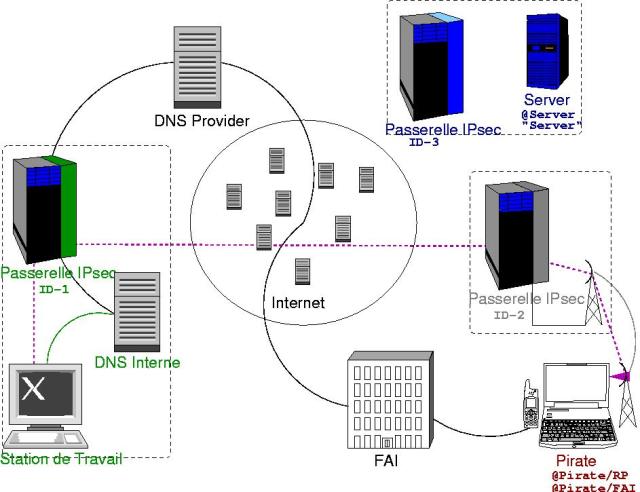
Dans ce scénario, trois réseaux interviennent. La
passerelle de sécurité du client (ID-1) est capable
d'authentifier les passerelles de sécurité des deux
autres réseaux (ID-2 et ID-3), parce qu'elle connaît
leurs clefs publiques ou parce qu'elle partage un
secret avec elles. Respectivement, les passerelles des
autres réseaux sont capables d'authentifier ID-1. En
revanche, les passerelles ID-2 et ID-3 peuvent ne pas
se connaître, appartenir à des entreprises différentes,
voire concurrentes.
Le pirate a réussi à accéder au réseau dans lequel se
trouve la passerelle ID-2 grâce à la portée trop
importante du réseau wireless (cf. ``Conducting
the Site Survey'', p39,
[AS02]). Il
dispose d'une adresse, @pirate/RP, dans ce réseau
privé, et d'une autre adresse, @pirate/FAI, sur
le réseau d'un fournisseur d'accès internet auquel il
accède par GSM (il existe des moyens plus discrets pour
obtenir le même résultat, dont il ne sera pas question
ici pour des raisons de simplicité). Eventuellement, le
pirate peut agir de concert avec un autre pirate.
En dehors des requêtes DNS depuis les serveurs DNS
internes, tout trafic interne à destination d'un site
inconnu est rejeté au niveau de la passerelle. Les
échanges sont donc authentifiés, chiffrés, etc.,
systématiquement, et aucune discussion n'est engagée
avec des systèmes inconnus autres que les DNS des
providers.
Le pirate (ou un de ses complices), empoisonne un cache
DNS judicieusement choisi (DNS du FAI, ou d'un
domaine intervenant dans la résolution), et provoque
l'association du nom
serveur à
l'adresse @pirate/RP.
Lorsque la station de travail tente de se connecter au
serveur, une résolution DNS est faite (Station de
travail <-> DNS interne <-> DNS provider
<-> DNS d'Internet <-> DNS empoisonné), qui
retourne la mauvaise adresse IP.
Le client envoie alors ces paquets à destination de
@pirate/RP. La passerelle de sécurité ID-1
reconnaît l'adresse comme appartenant au réseau dans
lequel se trouve ID-2, et établit une association de
sécurité avec ID-2. Les paquets à destination du
serveur, qui auraient dû passer par ID-3 sont ainsi
amenés à passer par ID-2. ID-2 les décapsule et les
envoie au pirate. IPsec a donc été détourné de son
objectif initial et a protégé une communication qui
était illicite !
On pourrait simplifier le scénario en supposant que le
pirate est un utilisateur régulier du réseau protégé par
ID-2 et procède à cette attaque pour obtenir des
informations sur son concurrent (protégé par ID-3) en
trompant son fournisseur ou son acheteur.
Dans tous ces scénarios, ce n'est pas tant les
faiblesses d'IPsec qui sont en cause que celles du DNS
ou l'ignorance des utilisateurs qui ont tendance à
associer de façon rigide adresse IP, nom DNS, et
identité pour IKE. Comme souvent, c'est le maillon le
plus faible qui est exploité. Etablir ses propres DNS
et limiter la confiance dans les DNS
non authentifiables constitue une pratique raisonnable
pour la sécurité, bien que peu dynamique pour le service
rendu.
IPsec et la Translation d'Adresse (NAT)
Afin de remplir les objectifs énoncés ci-dessus, les
implémentations classiques de translateurs d'adresses
peuvent mettre en oeuvre deux types de solution :
[SE01], de très nombreux dispositifs NAT sont
capables d'utiliser les deux techniques précédentes,
i.e. d'opérer dans un premier temps en ``Basic NAT'',
puis de passer en ``NAPT'' quand les adresses publiques
viennent à manquer. Il existe par ailleurs d'autres
pratiques pour le NAT, mais ces dernières sont plus
rares (le lecteur en trouvera une liste non exhaustive
avec description au §4 de [SH99]).
De part l'isolation qu'il instaure entre réseau interne
et réseau externe, le NAT est considéré par certains
comme un dispositif de sécurité. En effet, en l'absence
de définition de liaison statique entre des coordonnées
(adresse pour le ``Basic NAT'' ou couple (adresse, port)
pour ``NAPT'') externes et internes, un système
extérieur n'a pas le droit d'établir une connexion avec
un système interne (les connexions issues de
l'extérieur sont interdites). Seules les sessions
établies depuis l'intérieur sont alors autorisées.
Cependant, le premier usage des translateurs est de
répondre au manque d'adresse IPv4, les avantages en
terme de sécurité constituent plutôt un effet
secondaire dont il faut connaître les limitations.
Malheureusement, on a pu constater dans les fiches
techniques de certains constructeurs (U.S. Robotics et
surtout BeWAN Systems) que le NAT est listé dans les
dispositifs de sécurité (avec le pare-feux, la zone
démilitarisée, IPsec et le verrouillage horaire) et non
dans les fonctionnalités de connectivé (où l'on trouve
DynDNS et DHCP).
Quelques problématiques de sécurité liées à
l'utilisation du NAT sont les suivantes :
Le §2.1 de
[SE01] souligne que l'utilisation
du NAT n'affecte en rien le fonctionnement des deux
réseaux (privé et public), à condition bien sûr que NAT
puisse effectuer ses opérations. Notamment, NAT
n'affecte en rien le routage.
Par conséquent, il est possible d'utiliser IPsec dans
n'importe lequel des deux réseaux, mais pas entre les
deux (voir partie suivante).
On trouve ainsi sur le marché des dispositifs NAT &
VPN, et ces dispositifs constituent de bonnes solutions
de connectivité SOHO (Satellite Office - Home Office).
En réception, les paquets sont traités tout d'abord par
IPsec, puis par NAT, et sont enfin acheminés vers l'hôte
interne. En émission, le NAT effectue la translation,
puis fournit le paquet à IPsec avant émission sur le
réseau public.
L'utilisation du NAT à l'issu de l'application d'une
protection par IPsec est fatale. Notamment, un scénario
aussi simple que le suivant ne pourra fonctionner :
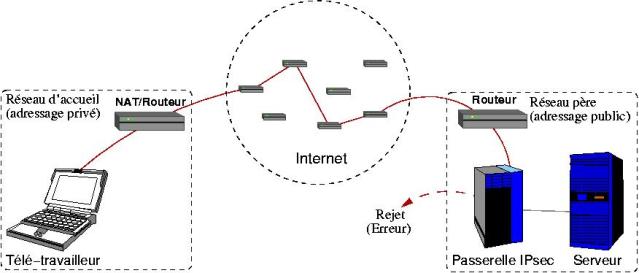 De même, les utilisateurs mobiles se connectant depuis un aéroport ou un hôtel ont de fortes chances d'être derrière un translateur (et dans ces exemples, la sécurité n'est absolument pas facultative). Enfin, même les Fournisseurs d'Accès Internet commencent à manquer d'adresses publiques et utilisent d'ores et déjà des translateurs d'adresse sur le terrain (Wanadoo et Oléane).
Des causes diverses participent à cet échec.
Si on
considère l'utilisation de AH (en mode transport ou en
mode tunnel), les opérations effectuées par le NAT
- modification des adresses source et destination, et
éventuellement des identifiants de niveau transport -
compromettent l'intégrité du paquet, en conséquence de
quoi IPsec le rejettera.
Si on considère l'utilisation de
ESP, les données protégées sont chiffrées et/ou
authentifiées. Cela implique qu'une modification de ces
données fera échouer IPsec. Or, les protocoles de
transport les plus utilisés incorporent une somme
de contrôle qui dépend des adresses source et
destination : UDP
[Pos80], TCP [Pos81-2] et SCTP
[SCTP00] font parti de ces protocoles.
Les opérations effectuées par le NAT requièrent donc la
modification des sommes de contrôle de ces protocoles.
Cette contrainte est allégée pour UDP, pour lequel une
somme de contrôle nulle est suffisante (cf. [Bra89] et voir plus haut :``IPsec et la
Couche Transport'') : les différentes
implémentations d'UDP recevant cette valeur doivent
ignorer la vérification de la somme de contrôle.
Les parties suivantes viennent compléter avec force de
détails les remarques précédentes. Elles s'appuient sur
le document
[AD02] du 18 août 2002 dont
l'objectif est justement le recensement des
incompatibilités entre IPsec et le NAT.
Ces incompatibilités sont inhérentes au principe
de fonctionnement de NA(P)T.
Ces incompatibilités sont le fait
d'implémentations maladroites mais
malheureusement très répandues. On ne devrait
plus les rencontrer dans les implémentations
futures.
Très peu de dispositifs NAPT répondent
correctement aux problèmes de fragmentation
présentés ci-avant.
Certaines implémentations mettent en place des
mécanismes sensés aider le passage de certains
protocoles. Ces mécanismes ont cependant des
inconvénients assez lourds.
Les drafts
[HSSVD02] et [KHSV02]
apportent depuis peu une solution aux problèmes causés
par les NATs. Comme mentionné plus haut, le trafic UDP
sur IPv4 a des affinités avec NAT, notamment parce que
le calcul de la somme de contrôle est facultatif. Il
s'agit d'ailleurs du protocole de transport qui cause
le moins d'incompatibilités avec NAT. Les
contraintes énoncées par le draft des ``requirements''
([AD02]) précisent qu'une solution ne doit pas
impliquer des modifications dans le réseau, i.e. sur les
routeurs ou les dispositifs NAT. En conséquence de quoi,
la construction d'un tunnel UDP semble toute indiquée.
D'emblée, AH est exclu, de part la portée de son
contrôle d'intégrité, qui est trop grande. ESP Tunnel
et ESP Transport sont supportés explicitement par le
draft. Dans le cas de ESP Transport, c'est le support de
L2TP/IPsec (
[PADZB01]) qui est visé, puisque
cette technologie va connaître une diffusion importante
(au sein des systèmes d'exploitation et des routeurs),
et parce que Microsoft et Cisco sont des acteurs
important dans les travaux concernant l'interopérabilité
de NAT et de IPsec.
Le principe de ce tunnel UDP
[HSSVD02] est
relativement simple : Les
partenaires de l'association de sécurité communiquent
via le port UDP 4500, et des ports dynamiques sont
alloués sur le NAT. Les paquets UDP encapsulent tout le
trafic IPsec :
Cette solution implique cependant de nombreuses
précautions. Ainsi, en mode tunnel, une politique doit
être mise en place afin de ne pas avoir d'incohérence
d'adresses, par exemple entre deux réseaux privés
utilisant tous les deux le sous-réseau 10.0.0.0/8. Dans
ce cas, on peut envisager d'assigner au partenaire une
adresse, ou on peut effectuer du ``Basic NAT''. En mode
transport, c'est le calcul des sommes de contrôle (pour
TCP, etc.) qui requiert le même type de mesure.
Enfin, d'incontournables brèches de sécurité se
révèlent :
Pour repérer la présence d'un ou plusieurs NAT et pour
déterminer si le partenaire supporte la traversée du NAT
pour IPsec,
[KHSV02] propose plusieurs ajouts
à IKE :
Ces ajustements sur le comportement de IKE introduisent
aussi quelques nouvelles failles de sécurité :
Les difficultés posées par le NAT semblent en passe
d'être résolues. Bien que les besoins présentés dans
[AD02] soient cohérents, il est regrettable
que l'utilisation conjointe du NAT et d'IPsec soit
présentée dans ce draft comme un mécanisme de transition
avant que le réseau ne passe totalement à IPv6. Cette
phase de transition risque d'avoir une durée non
négligeable, et il est probable que le réseau IPv4
existera toujours en parallèle.
Conclusion
Les incompatibilités présentées dans ce rapport témoignent pour
la mise en application de pratiques de sécurité plus raisonnées :
tenter de sécuriser un protocole tel que IP après son déploiement
à grande échelle rend impossible l'éradication de ses tumeurs.
L'explosion des nouveaux protocoles et mécanismes en coeur de
réseau n'allège pas non plus la pression sur IPsec. Peut-être
qu'une opportunité de saisir la bride dès le départ se présente
avec IPv6 ?
Coordonnées des auteurs
Jean-Jacques Puig Doctorant Mail :
Site Web :
Organisation : I.N.T Adresse : Jean-Jacques Puig, Pièce A109, Département Logiciels-Réseaux (LoR), Institut National des Télécoms (INT), 9 Rue Charles Fourier, 91011 Evry Cédex Téléphone : 01.60.76.44.65 Fax : 01.60.76.47.11
Maryline Laurent-Maknavicius Maître de Conférence Mail :
Site Web :
Organisation : I.N.T Adresse : Maryline Laurent-Maknavicius Pièce A106-02, Département Logiciels-Réseaux (LoR), Institut National des Télécoms (INT), 9 Rue Charles Fourier, 91011 Evry Cédex Téléphone : 01.60.76.44.42 Fax : 01.60.76.47.11
Jean-Jacques - Puig Octobre 2002 Ce document est diffusé sous licence FDL 1.1 ou toute autre version ultérieure établie par la Free Software Fondation. Pour plus de renseignements, reportez-vous à http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. |